
Autour de la musique classique
Le but de ce forum est d'être un espace dédié principalement à la musique classique sous toutes ses périodes, mais aussi ouvert à d'autres genres.
|
| | | Rodion Shchedrin (1932-) |  |
|
+15/ Mélomaniac Francoistit Анастасия231 Xavier Cololi Polyeucte jibv Ophanin Cello Percy Bysshe DavidLeMarrec WoO vincent.1976 Tus 19 participants | |
| Auteur | Message |
|---|
Benedictus
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565
Age : 49
Date d'inscription : 02/03/2014
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Sam 26 Oct 2019 - 0:02 Sam 26 Oct 2019 - 0:02 | |
| 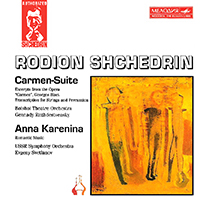 • Carmen-Suite¹. Anna Karénine, musique romantique² • Carmen-Suite¹. Anna Karénine, musique romantique²Guennadi Rojdestvenski / Cordes et Percussions de l’Orchestre du Théâtre du Bolchoï, Moscou¹. Evgueni Svetlanov / Orchestre Symphonique d’URSS² Moscou, 1967¹; II.1979²
Melodiya / BMG «Authorized Shchedrin»Grosse réévaluation de la Carmen-Suite. J’ai en effet été totalement électrisé par cette nouvelle écoute. Il est très vraisemblable que ça vienne en grande partie de l’interprétation: ici, la captation est très frontale et chaleureuse, le spectre très plein, très coloré et les cordes bien typées (alors que chez Pletnev les percussions sonnent très rond, comme ouatées par des cordes aussi soyeuses qu’envahissantes, et chez Kuchar, tout sonne très malingre et uniformément pâle), et surtout Rojdé dirige ça de façon très animée et contrastée (alors que Pletnev et Kuchar sont franchement indolents.) Du coup, on perçoit beaucoup mieux les singularités de l’œuvre: 1. Si l’on a le plaisir de retrouver les thèmes de Bizet, le traitement de Chtchédrine est très respectueux (aucune distorsion ironique - ce n’est pas du tout Chosta citant l’ouverture de Guillaume Tell) mais ne se contente pas d’une sorte de suite de tubes en réduction: le matériau y est retravaillé et réorganisé suivant une logique narrative et dramatique propre, et très intense; 2. Le rendu du détail des timbres et des textures des percussions (le grain est vraiment formidable) permet de sentir l’extraordinaire maîtrise de l’écriture de Chtchédrine pour ces pupitres. Peu d’œuvres permettent d’entendre à ce point toutes les ressources de ces intruments, qui sont ici mobilisés pour produire des alliages de couleurs et des atmosphères harmoniques d’une incroyable richesse, et même pour déployer un discours mélodique singulièrement vivant et articulé. Donc vraiment une redécouverte enthousiaste! J’ai aussi bien aimé Anna Karénine, même si le langage, très soviétique m’y a semblé plus convenu. Il n’empêche que, même dans ce cadre classiquement «post-chostakovien», Chtchédrine m’a paru se distinguer par certaines qualités qui lui sont indiscutablement propres. D’abord, son efficacité narrative et dramatique: dans cette musique de ballet, Chtchédrine manifeste un art assez remarquable dans la gestion en continu d’un flux où la tension ne retombe jamais (par une certaine façon de retenir les effets de tension/détente, une utilisation assez frappante des rappels thématiques et des effets cycliques...), avec en particulier une manière tout à fait singulière de faire progresser le récit en accumulant continûment la tension jusqu’à des culminations qui ne ressemblent pas à des climaxes tonitruants, mais plutôt à de très beaux moments suspendus qui produisent un effet «œil du cyclone» (j’avais d’ailleurs déjà remarqué cette propension dans son opéra Le Voyageur ensorcelé.) D’autre part, d’une manière qui touche plus directement à l’écriture musicale, j’ai eu l’impression que Chtchédrine réalisait une sorte de «re-tchaïkovskisation» du langage chostakovien. C’est d’abord manifeste dans l’écriture mélodique: la syntaxe de Chtchédrine est bien cette tonalité cabossée aux harmonies grinçantes; mais, s’il sait l’utiliser ponctuellement pour créer des moments poisseux et évasifs (l’incipit, par exemple), il parvient aussi à la plier à une expression mélodique beaucoup plus franche et effusive, tantôt lyrique, tantôt conflictuelle (le sous-titre de l’œuvre est d’ailleurs «musique romantique») - et pour le coup assez éloignée des «mélodies déceptives», à l’expression déprimée ou sarcastique. C’est au moins aussi sensible dans l’orchestration: à la différence de Chostakovitch, qui procède souvent par grands aplats gris sur lesquels se détachent des solos toujours un peu semblables (caisse claire, violon crincrinant, vents nasillards...) et de grands tutti un peu opaques, Chtchédrine utilise de manière beaucoup plus variée tout l’empan des ressources de l’orchestre, avec une façon assez typiquement tchaikovskienne de «tuiler» des boucles mélodiques solistes aux timbres très variés, de créer des arrière-plans aux textures différenciées et stratifiés qui font ressortir les contrechants, et plus globalement d’exalter le matériau thématique en le faisant circuler entre des pupitres aux timbres très individualisés. Je ne connais pas d’autres versions de cette œuvre, mais il paraît évident que la manière expansive et directe de Svetlanov (sans doute accentuée par l’atmosphère du live) rend justice à l’espèce de romantisme renouvelé de l’écriture de Chtchédrine. Et même si cette musique n’est pas de celles qui me parlent le plus immédiatement, je dois dire que j’ai écouté cette œuvre avec un intérêt constant. |
|   | | Benedictus
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565
Age : 49
Date d'inscription : 02/03/2014
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Sam 26 Oct 2019 - 2:33 Sam 26 Oct 2019 - 2:33 | |
| - Анастасия231 a écrit:
- Meow !

Cela dit, je n'entends pas du tout de Mitia dans Anna Karénina (en revanche, des citations du 2e quatuor à cordes et de la 3e symphonie de Piotr Ilyitch ainsi que le matériau principal d'une musique que Chtchédrine a écrit pour la version cinématographique du Roman de Tolstoï en 1967, d'ailleurs son épouse Maïa y a participé dans un rôle secondaire). Qui plus est, il est difficile de se faire une idée globale d'un ballet de 85 minutes avec un réarrangement sous-titré "Musique Romantique" de 25 minutes, bien qu'on y gagne la voix de la prima ballerina assoluta du Bolchoï qui récite les dernières pensées d'Anna avant son suicide ferroviaire. C'est un peu comme juger la 5e de Mahler avec uniquement la Trauermarsch et l'Adagietto avec l'Ewig de Kathleen en supplément. - Анастасия231 a écrit:
- Cela dit, je n'entends pas du tout de Mitia dans Anna Karénina
Si tu préfères: ce langage harmonique qui est un peu la lingua franca de la musique soviétique, et dont Chostakovitch est quand même la figure la plus emblématique. (D'ailleurs, Chostakovitch a quand même bien influencé Chtchédrine, non?) - Анастасия231 a écrit:
- Qui plus est, il est difficile de se faire une idée globale d'un ballet de 85 minutes avec un réarrangement sous-titré "Musique Romantique" de 25 minutes, bien qu'on y gagne la voix de la prima ballerina assoluta du Bolchoï qui récite les dernières pensées d'Anna avant son suicide ferroviaire.
Mais est-ce que ce réarrangement ne doit pas être considéré comme une œuvre dérivée mais autonome? Rien que ce sous-titre («musique romantique» et non «suite de ballet») me l'avait donné à penser - disons que je m'imaginais qu'il s'agissait plutôt de quelque chose comme la Symphonie « Mathis der Maler» que comme les suites de Daphnis ou du Mandarin merveilleux. Au demeurant, comme ce n'est tout de même pas non plus un langage qui me touche si fortement (et que je ne suis pas du tout balletomane), je ne suis pas sûr que j'aurais autant apprécié 85 minutes de cette musique (alors que les 95 minutes de la 4ᵉ Symphonie de Tichtchenko, ça passe crème.) - Анастасия231 a écrit:
- C'est un peu comme juger la 5e de Mahler avec uniquement la Trauermarsch et l'Adagietto avec l'Ewig de Kathleen en supplément.
Ben justement, la 5ᵉ de Mahler, moins j'en ai, mieux c'est...  (Déjà, rien qu'en me dispensant du Scherzo et du Finale, ça passe mieux.) |
|   | | Golisande
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 7611
Age : 49
Localisation : jeudi
Date d'inscription : 03/03/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Sam 26 Oct 2019 - 13:22 Sam 26 Oct 2019 - 13:22 | |
| [hs]Mais c'est merveilleux, le Scherzo de la 5e de Mahler...[/hs] |
|   | | Анастасия231
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 14310
Age : 30
Localisation : Karl Marx est un ailurophile ukraïnien d'obédience léniniste
Date d'inscription : 05/01/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Sam 26 Oct 2019 - 17:39 Sam 26 Oct 2019 - 17:39 | |
| - Benedictus a écrit:
- Анастасия231 a écrit:
- Meow !

Cela dit, je n'entends pas du tout de Mitia dans Anna Karénina (en revanche, des citations du 2e quatuor à cordes et de la 3e symphonie de Piotr Ilyitch ainsi que le matériau principal d'une musique que Chtchédrine a écrit pour la version cinématographique du Roman de Tolstoï en 1967, d'ailleurs son épouse Maïa y a participé dans un rôle secondaire). Qui plus est, il est difficile de se faire une idée globale d'un ballet de 85 minutes avec un réarrangement sous-titré "Musique Romantique" de 25 minutes, bien qu'on y gagne la voix de la prima ballerina assoluta du Bolchoï qui récite les dernières pensées d'Anna avant son suicide ferroviaire. C'est un peu comme juger la 5e de Mahler avec uniquement la Trauermarsch et l'Adagietto avec l'Ewig de Kathleen en supplément.
- Анастасия231 a écrit:
- Cela dit, je n'entends pas du tout de Mitia dans Anna Karénina
Si tu préfères: ce langage harmonique qui est un peu la lingua franca de la musique soviétique, et dont Chostakovitch est quand même la figure la plus emblématique. (D'ailleurs, Chostakovitch a quand même bien influencé Chtchédrine, non?) Figure emblématique certes, mais il n'était pas l' Unique option inébranlable de l'art musical soviétique. Sinon, tu as raison, Rodion Konstantinovitch a été bel et bien influencé par Mitia mais cette influence s'est quelque peu diluée, estampée dans la second moitié des années 1960 au profit de l'école polonaise et de l'école "Vieille Russie" sous l'égide bienveillante de Sviridov (2e concerto pour orchestre "Les Cloches", Poétoria, Lénine est dans le cœur du peuple...). - Benedictus a écrit:
- Анастасия231 a écrit:
- Qui plus est, il est difficile de se faire une idée globale d'un ballet de 85 minutes avec un réarrangement sous-titré "Musique Romantique" de 25 minutes, bien qu'on y gagne la voix de la prima ballerina assoluta du Bolchoï qui récite les dernières pensées d'Anna avant son suicide ferroviaire.
Mais est-ce que ce réarrangement ne doit pas être considéré comme une œuvre dérivée mais autonome? Rien que ce sous-titre («musique romantique» et non «suite de ballet») me l'avait donné à penser - disons que je m'imaginais qu'il s'agissait plutôt de quelque chose comme la Symphonie «Mathis der Maler» que comme les suites de Daphnis ou du Mandarin merveilleux.
Au demeurant, comme ce n'est tout de même pas non plus un langage qui me touche si fortement (et que je ne suis pas du tout balletomane), je ne suis pas sûr que j'aurais autant apprécié 85 minutes de cette musique (alors que les 95 minutes de la 4ᵉ Symphonie de Tichtchenko, ça passe crème.) Encore une fois, je dois te donner raison sur les intentions formelles de cette "Musique Romantique". Et puisque la musique de ballet n'est pas ton dada... je ne veux pas t'y forcer la main. Mais c'est dommage. - Benedictus a écrit:
- Анастасия231 a écrit:
- C'est un peu comme juger la 5e de Mahler avec uniquement la Trauermarsch et l'Adagietto avec l'Ewig de Kathleen en supplément.
Ben justement, la 5ᵉ de Mahler, moins j'en ai, mieux c'est... 
(Déjà, rien qu'en me dispensant du Scherzo et du Finale, ça passe mieux.) Dans ce cas, je recommence : C'est un peu comme juger la 6e de Mahler uniquement sur le Scherzo et l'Andante (ou/et inversement) avec un extrait des Kindertoten-Lieder par Kathleen à la fin.  |
|   | | Alifie
Googlemaniac

Nombre de messages : 20060
Date d'inscription : 29/01/2012
 | |   | | Анастасия231
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 14310
Age : 30
Localisation : Karl Marx est un ailurophile ukraïnien d'obédience léniniste
Date d'inscription : 05/01/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Lun 28 Oct 2019 - 22:13 Lun 28 Oct 2019 - 22:13 | |
| Il se trouve que le danseur cubain en question était justement le chorégraphe de ce ballet, Alberto Alonso.  /watch?v=uciCPeNHCVw |
|   | | Benedictus
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565
Age : 49
Date d'inscription : 02/03/2014
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Dim 8 Jan 2023 - 15:49 Dim 8 Jan 2023 - 15:49 | |
| 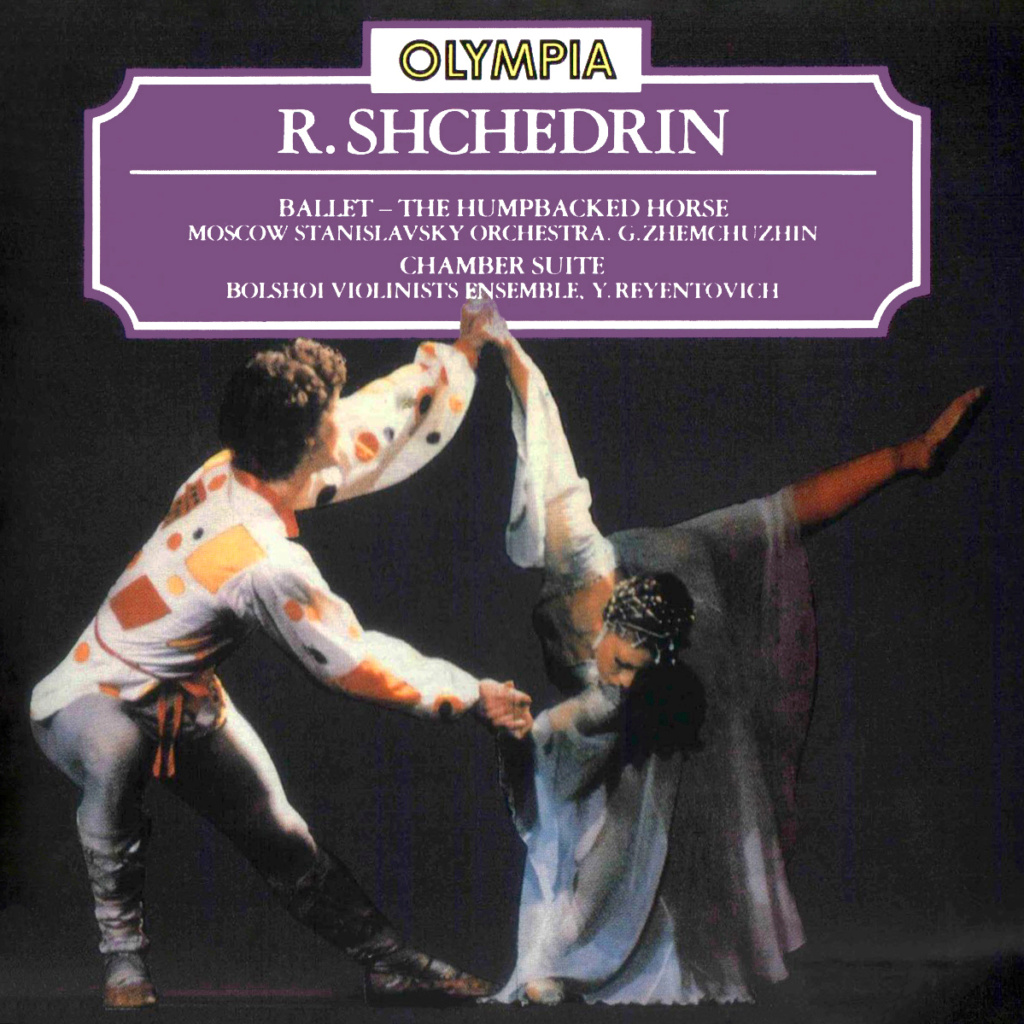 • Le Petit Cheval bossu (Конёк-Горбунок) (1956) • Le Petit Cheval bossu (Конёк-Горбунок) (1956)Georgi Zhemchuzhin / Orchestre du Théâtre Musical Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko de Moscou 1988
OlympiaC’est très, très chouette! Le langage est absolument traditionnel (en fait, on pourrait penser au Stravinsky rimskien, mais en moins retors harmoniquement), voire conservateur (ça n’est même pas soviétisé à la Prokofiev), mais c’est une œuvre vraiment très réussie dans son genre: l’orchestration regorge de couleurs vives (voire un peu crues, dans une veine plutôt folklorisante - ça n’a pas le côté post-tchaikovskien d’ Anna Karénine) et d’effets qu’on pourra certes trouver naïfs mais qui tombent toujours très bien que ce soit en termes de narration ou de climats - et surtout c’est merveilleusement conçu pour la danse: les rythmes y sont variés mais toujours relancés, ça tournoie de façon assez irrésistible. Même moi qui ne suis pas forcément le meilleur client pour ce genre de musique «au premier degré», je ne me suis pas ennuyé une seconde (alors que le ballet intégral est quand même assez long.) |
|   | | DavidLeMarrec
Mélomane inépuisable

Nombre de messages : 97661
Localisation : tête de chiot
Date d'inscription : 30/12/2005
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Dim 8 Jan 2023 - 17:28 Dim 8 Jan 2023 - 17:28 | |
| Oui, c'est vraiment très chouette ! Simplement aimable et plaisant, d'une certaine façon, mais tellement bien conçu, plein de couleurs et de vitalité, qu'on rend les armes. |
|   | | Анастасия231
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 14310
Age : 30
Localisation : Karl Marx est un ailurophile ukraïnien d'obédience léniniste
Date d'inscription : 05/01/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Dim 8 Jan 2023 - 22:23 Dim 8 Jan 2023 - 22:23 | |
| C'est la magie tardive du Noël russe orthodoxe qui fait son petit effet !  Quand je pense que je suis fanatique de cette musique depuis mes 17 ans... Quand je pense que je suis fanatique de cette musique depuis mes 17 ans... |
|   | | Benedictus
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565
Age : 49
Date d'inscription : 02/03/2014
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Dim 8 Jan 2023 - 23:01 Dim 8 Jan 2023 - 23:01 | |
| - Анастасия231 a écrit:
- C'est la magie tardive du Noël russe orthodoxe qui fait son petit effet !

Quand je pense que je suis fanatique de cette musique depuis mes 17 ans... Oui, c'est ton récent post qui m'a donné envie d'essayer! (C'est quand même un langage qui me parle moins immédiatement que ceux de beaucoup de soviétiques de la même génération.) Je vais d'ailleurs essayer dans les jours qui viennent Anna Karénine et La Dame au petit chien (je n'ai pas réussi à me procurer La Mouette.) |
|   | | DavidLeMarrec
Mélomane inépuisable

Nombre de messages : 97661
Localisation : tête de chiot
Date d'inscription : 30/12/2005
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Dim 8 Jan 2023 - 23:03 Dim 8 Jan 2023 - 23:03 | |
| Les deux sont vraiment moins bien. En revanche Le Vagabond Ensorcelé, il y a l'apparition de Groucha, hors du temps – au disque, c'est moins saisissant qu'en scène, mais ça reste très beau, assez nu, au sein d'un langage environnant beaucoup plus hardi que le Cheval (mais que tu trouveras peut-être trop babillard, surtout sans livret). |
|   | | Benedictus
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565
Age : 49
Date d'inscription : 02/03/2014
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Dim 8 Jan 2023 - 23:22 Dim 8 Jan 2023 - 23:22 | |
| - DavidLeMarrec a écrit:
- Les deux sont vraiment moins bien.
Ah? Je me souviens avoir plutôt bien aimé la «musique romantique pour grand orchestre» tirée d' Anna Karénine (dans une genre plus néo-tchaikovskien.) - DavidLeMarrec a écrit:
- En revanche Le Vagabond Ensorcelé, il y a l'apparition de Groucha, hors du temps – au disque, c'est moins saisissant qu'en scène, mais ça reste très beau, assez nu, au sein d'un langage environnant beaucoup plus hardi que le Cheval (mais que tu trouveras peut-être trop babillard, surtout sans livret).
Ah, mais je connais bien Le Vagabond ensorcelé - et j'aime en effet beaucoup. |
|   | | Анастасия231
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 14310
Age : 30
Localisation : Karl Marx est un ailurophile ukraïnien d'obédience léniniste
Date d'inscription : 05/01/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Lun 9 Jan 2023 - 2:31 Lun 9 Jan 2023 - 2:31 | |
| - Benedictus a écrit:
- [...]je n'ai pas réussi à me procurer La Mouette.
Oh non, c'est mon préféré.  Si jamais, un lien magique : /watch?v=g9VbmvyU7Lk
Dernière édition par Анастасия231 le Lun 9 Jan 2023 - 3:08, édité 1 fois |
|   | | Анастасия231
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 14310
Age : 30
Localisation : Karl Marx est un ailurophile ukraïnien d'obédience léniniste
Date d'inscription : 05/01/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Lun 9 Jan 2023 - 2:45 Lun 9 Jan 2023 - 2:45 | |
| - Benedictus a écrit:
- DavidLeMarrec a écrit:
- Les deux sont vraiment moins bien.
Ah? Je me souviens avoir plutôt bien aimé la «musique romantique pour grand orchestre» tirée d'Anna Karénine (dans une genre plus néo-tchaikovskien.) David n'aime pas les locomotives, ni les nobliaux sadiques et misogynes, encore moins les duos de Bellini...  Je suis tombée du fauteuil avec mon jus de fruit lorsque j'ai entendu le ballet intégral d' Anna Karenina pour la première fois - sur mon ancien mp3 (!) ; c'était une soirée suave et nonchalante de juillet 2011. J'ai rarement eu une telle chair de poule... m'enfin, c'était avant ma période Schnittke (lol). Par ailleurs, la représentation des danseurs et de l'orchestre du Mariinsky au Grand Théâtre de Genève le 18 avril 2012 reste le souvenir le plus précieux que je garderai jusqu'à ma dernière respiration. Musicalement, c'est la Musique Romantique en trois fois plus long niveau minutage : il n'y a strictement rien à jeter, c'est un chef-d'œuvre absolu amha.  |
|   | | DavidLeMarrec
Mélomane inépuisable

Nombre de messages : 97661
Localisation : tête de chiot
Date d'inscription : 30/12/2005
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Lun 9 Jan 2023 - 21:52 Lun 9 Jan 2023 - 21:52 | |
| - Benedictus a écrit:
- DavidLeMarrec a écrit:
- Les deux sont vraiment moins bien.
Ah? Je me souviens avoir plutôt bien aimé la «musique romantique pour grand orchestre» tirée d'Anna Karénine (dans une genre plus néo-tchaikovskien.) J'avais trouvé ça néo-tcha moi aussi, mais vraiment affadi (écouté pas mal de fois, à chaque fois abusé par le nom du compositeur et les promesses du programme). Les Âmes mortes se trouvaient grâce à Operavision, j'ai peut-être encore ça quelque part si tu vises l'exhaustivité ! |
|   | | Benedictus
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565
Age : 49
Date d'inscription : 02/03/2014
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Sam 21 Jan 2023 - 16:46 Sam 21 Jan 2023 - 16:46 | |
| En Playlist: - Benedictus a écrit:
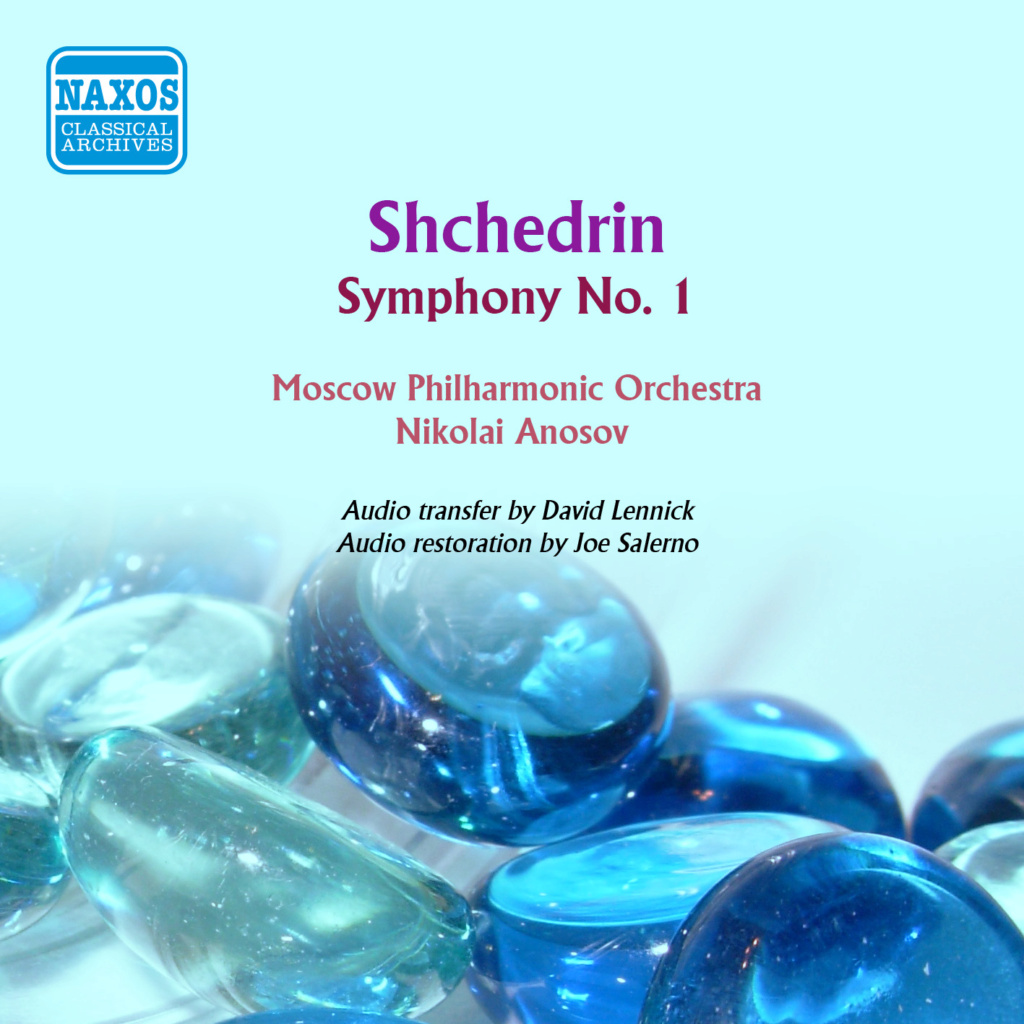
• Symphonie n°1 en mi bémol majeur (1958)
Nikolai Anosov / Orchestre Philharmonique de Moscou
1962
Naxos «Classical Archives»

• Symphonie n°2 (25 Préludes pour orchestre) (1962-65)
Guennadi Rojdestvenski / Orchestre Symphonique de Moscou
1965
Melodiya
 La symphonie ne me semble tout de même pas le genre où Rodion Constantinovitch se sera montré le plus inspiré… (En tout cas, de n'est pas celui où il me touche ou m'intéresse le plus.) La symphonie ne me semble tout de même pas le genre où Rodion Constantinovitch se sera montré le plus inspiré… (En tout cas, de n'est pas celui où il me touche ou m'intéresse le plus.) - Анастасия231 a écrit:
- Même la 2e ?
  Je dirais même: surtout la 2ᵉ! En fait, je crois que mon appréciation dépend largement de mes attentes vis-à-vis du genre «symphonie»: disons que quand j’écoute une symphonie, c’est que j’ai envie d’entendre une élaboration formelle, un discours structuré, des développements. Alors, la 1ᵉ, certes, c’est un peu de la symphonie soviétique assez standard (malgré une certaine veine mélodique prégnante, j’ai l’impression que ça pourrait aussi bien avoir été composé par Chébaline, Khrennikov ou Salmanov) mais je trouve au moins de quoi soutenir mon attention quand j’entends trois mouvements en forme, respectivement, de rondo, de toccata et de variations. Mais quand même: je trouve l’harmonie vraiment trop stable pour mon goût, et il me manque ce que j’aime d’habitude dans sa musique: j’ai trouvé ainsi que (surtout dans le I et le III), il y avait beaucoup de baisses de tension et de temps morts (alors que Chtchédrine, en particulier dans ses œuvres scéniques, a souvent une espèce de don pour relancer sans arrêt l’intérêt), et que l’orchestration était assez opaque (sans les couleurs et les textures qui m’enchantent d’habitude dans l’orchestre de Chtchédrine.) En revanche, ce qui m’a totalement fait décrocher dans la 2, c’est le côté totalement informe de l’œuvre - cela dit, j’en conviens, le sous-titre «25 Préludes pour orchestre» pouvait le laisser deviner: c’est vraiment une suite de miniatures orchestrales sans développement, et dont j’ai du mal à saisir la continuité ou la nécessité. Par ailleurs, j’y ai en effet - par rapport à la 1ᵉ - bien davantage retrouvé la touche de Chtchédrine: à la fois ce que j’aime (les espèces de moments suspendus - mais pas dénués de tension - qui surgissent au milieu du tumulte, comme un effet «œil du cyclone»), ce que je trouve frappant sans forcément aimer (ces espèces de glissements cinétiques avec des effets de clusters dissonants un peu cauchemardesques) mais aussi, et un peu trop souvent en fait, ce que j’aime le moins (les grands fracas frontaux, les fanfares grinçantes, les superpositions de strates, les ploum-ploums bien tonals avec çà et là quelques dissonances.) Disons pour ces dernières que c’est des choses qui arrivent à passer pour moi (et qui, objectivement, fonctionnent très bien) quand c’est justifié en tant qu'effet figuraliste, dans un contexte narratif ou dramatique, comme dans ses ballets ou ses opéras - en revanche, là, dans ce contexte abstrait, ça paraît assez arbitraire en plus d’être bruyant. En revanche, je suis en train d’écouter Anna Karénine: là, pour le coup, même ce que je n’aime pas chez Chtchédrine fonctionne vraiment très bien. |
|   | | Benedictus
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 15565
Age : 49
Date d'inscription : 02/03/2014
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Dim 22 Jan 2023 - 3:19 Dim 22 Jan 2023 - 3:19 | |
| 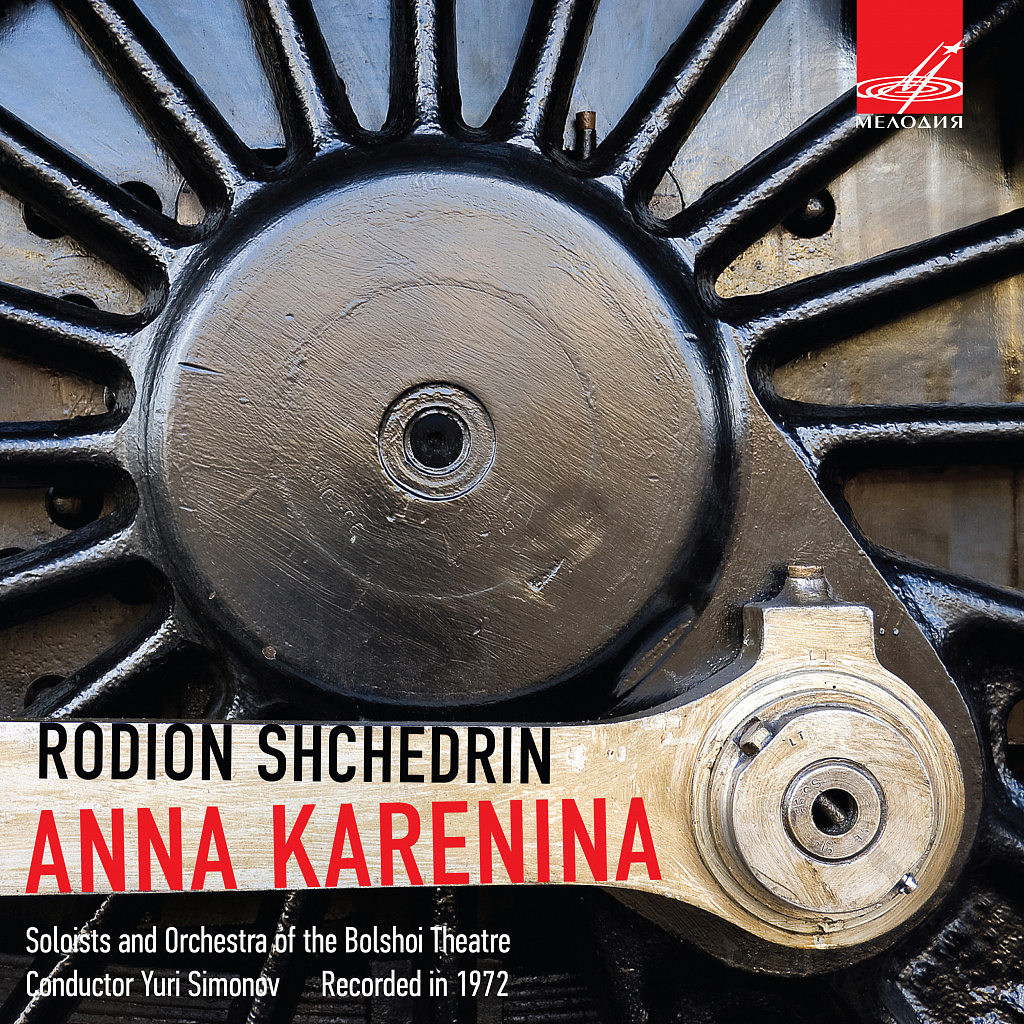 • Anna Karénine (Анна Каренина) (1971), • Anna Karénine (Анна Каренина) (1971), Scènes lyriques, ballet en 3 actes d’après le roman de Tolstoï Yuri Simonov / Orchestre du Théâtre Bolchoï; Roman Altayev / Harmonie de scène du Théâtre Bolchoï, Elena Kokhanova (piano), Anatoly Valetny (contrebasse), Denis Korolev (ténor), Nelya Lebedeva (soprano) 1972
MelodiyaSur un vague fond d’harmonies déceptives typiquement soviétiques, la tentation d’un lyrisme tchaikovskien vraiment très néo (parfois gentil, parfois dégoulinant - mais parfois aussi assez enthousiasmant: vraiment tchaikovskien pour le coup, que ce soit dans l’exaltation mélodique du sentiment ou au contraire dans les atmosphères dépressives un peu poisseuses), ponctué d’épisodes de grosse musique à effets bruyants et d’un figuralisme vraiment frontal (l’épisode aux courses!), voire de purs pastiches de musique XIXᵉ (entre les Strauss et Waldteufel dans le bal, Bellini dans la scène à l’opéra italien) - avec soudain tout qui s’emballe dans des espèces de cacophonies où différentes strates se juxtaposent avec parfois des effets cinétiques pas loin de collages schnittkiens… Logiquement, je n’aurais pas dû aimer, et pourtant… C’est, quand on connaît le roman, d’une telle force narrative et évocatrice qu’on est happé par le récit, même sans le support visuel, d’autant que comme dans Le Petit Cheval bossu dont je parlais l’autre jour (et qui n’a pourtant rien à voir, que ce soit dans le langage et les couleurs), y fait preuve d’un savoir-faire incroyable de la relance (ne serait-ce que par le rythme et l’art des tensions-détentes.) Et puis, surtout, les terribles évocations ferroviaires qui ouvrent et ferment le ballet sont d’une force incroyable: cette façon de construire l’idée de pressentiment dans le 1 (parce que tout le monde sait bien comment l’histoire se termine - mais Chtchédrine ne se contente pas de tabler là-dessus) et de conclure sans phrases dans une impression d’impavidité mécanique pleine d’amertume, c’est vraiment très, très impressionnant. Pas sûr de réécouter souvent - je crois que, pour mon goût personnel, je reviendrai plus volontiers à la Musique romantique pour grand orchestre dont j’avais déjà parlé il y a longtemps, un peu plus haut (et qui reprend, outre les scènes à la gare de Nikolaïevsk du début et de la fin, surtout les passages tchaikovskisants les plus réussis, ceux de l’introspection «psychologique») - mais j’ai quand même été bluffé du début à la fin. |
|   | | DavidLeMarrec
Mélomane inépuisable

Nombre de messages : 97661
Localisation : tête de chiot
Date d'inscription : 30/12/2005
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Mer 25 Jan 2023 - 14:15 Mer 25 Jan 2023 - 14:15 | |
| Je suis en train de réécouter ça. Beaucoup moins sucré que dans mon souvenir (très soviétisant la plupart du temps, même grinçant-grotesque par moment – la Chute de Vronski), mais il y a des citations littérales ou déformées de Tchaïkovski (premier mouvement de la Première Symphonie, par exemple) qui sont assez réjouissantes.
Je suis d'accord, évocation très réussie de la gare. |
|   | | DavidLeMarrec
Mélomane inépuisable

Nombre de messages : 97661
Localisation : tête de chiot
Date d'inscription : 30/12/2005
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Mer 25 Jan 2023 - 14:35 Mer 25 Jan 2023 - 14:35 | |
| Et dans la Cérémonie au Palais, on entend une réorchestration du final de la Symphonie n°3 de Tchaïkovski, c'est plus rare ça ! |
|   | | Анастасия231
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 14310
Age : 30
Localisation : Karl Marx est un ailurophile ukraïnien d'obédience léniniste
Date d'inscription : 05/01/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Mer 25 Jan 2023 - 15:17 Mer 25 Jan 2023 - 15:17 | |
| - DavidLeMarrec a écrit:
- Je suis en train de réécouter ça. Beaucoup moins sucré que dans mon souvenir (très soviétisant la plupart du temps, même grinçant-grotesque par moment – la Chute de Vronski), mais il y a des citations littérales ou déformées de Tchaïkovski (premier mouvement de la Première Symphonie, par exemple) qui sont assez réjouissantes.
Je suis d'accord, évocation très réussie de la gare. Troisième symphonie également ; il n'y a pas de fragment de la 1e symphonie étant donné que Chtchédrine a voulu insérer des citations de Tchaïkovsky qui soient contemporaines de l'ouvrage de Tolstoï (soit 1875)... et l'andante ma non tanto du 2e quatuor à cordes dès l'introduction (!).  |
|   | | DavidLeMarrec
Mélomane inépuisable

Nombre de messages : 97661
Localisation : tête de chiot
Date d'inscription : 30/12/2005
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Mer 25 Jan 2023 - 15:50 Mer 25 Jan 2023 - 15:50 | |
| - Анастасия231 a écrit:
- DavidLeMarrec a écrit:
- Je suis en train de réécouter ça. Beaucoup moins sucré que dans mon souvenir (très soviétisant la plupart du temps, même grinçant-grotesque par moment – la Chute de Vronski), mais il y a des citations littérales ou déformées de Tchaïkovski (premier mouvement de la Première Symphonie, par exemple) qui sont assez réjouissantes.
Je suis d'accord, évocation très réussie de la gare.
Troisième symphonie également ; il n'y a pas de fragment de la 1e symphonie étant donné que Chtchédrine a voulu insérer des citations de Tchaïkovsky qui soient contemporaines de l'ouvrage de Tolstoï (soit 1875)... et l'andante ma non tanto du 2e quatuor à cordes dès l'introduction (!).  Ah, je vais aller réécouter pour voir de quel mouvement c'est tiré alors ! C'était vers le début. |
|   | | Анастасия231
Mélomane chevronné

Nombre de messages : 14310
Age : 30
Localisation : Karl Marx est un ailurophile ukraïnien d'obédience léniniste
Date d'inscription : 05/01/2011
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  Mer 25 Jan 2023 - 22:42 Mer 25 Jan 2023 - 22:42 | |
| Début de l'allegro brillante initial, puis le thème mélancolique secondaire qui précède le développement (premier mouvement : Introduzione e Allegro).  |
|   | | Contenu sponsorisé
 |  Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-) Sujet: Re: Rodion Shchedrin (1932-)  | |
| |
|   | | | | Rodion Shchedrin (1932-) |  |
|
Sujets similaires |  |
|
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|
