Pauline Viardot (1821-1910)
"Il y a un enfant qui nous effacera tous : c'est ma sœur, qui a dix ans."
Maria Malibran
S'intéresser à Pauline Viardot, c'est s'intéresser à toute la vie culturelle européenne du XIXème siècle. Sœur de l'illustre Malibran, elle est restée dans son ombre pour l'histoire, alors qu'en y regardant de plus prêt, son importance dans la création artistique aura été beaucoup plus grande.
I. Une enfance musicale :
La jeune Pauline née le 18 juillet 1821 "dans une famille où le génie semblait héréditaire" dira plus tard Franz Liszt en 1859. Ses parents ne sont autre que le célèbre ténor Manuel Garcia (grand ami de Rossini, créateur de plusieurs de ses rôles les plus prestigieux) ainsi que de Joaquina Sitchès-Garcia, cantatrice de moindre renom, mais tout aussi exigeante musicalement. Les autres membres de la famille ne sont pas en reste, puisque les deux frère et soeur de Pauline son Maria (la future Malibran, née en 1808) et Manuel (baryton puis grand pédagogue, né en 1805). Petite dernière de la famille, elle va dès sa plus tendre enfance baigner dans une atmosphère où la musique est primordiale. Alors que ses ainés font leurs débuts sur scène, elle va pouvoir en être la spectatrice assidue, voyant ainsi les premiers pas de sa sœur sur en 1824 Rue Richelieu, ou un an plus tard lors d'un récital avec le dernier castra Velluti. Lors de la visite en Amérique qui verra le mariage de sa soeur, elle va par exemple assister à la première représentation du Barbier de Séville, où son père chante Almaviva, son frère Figaro, sa sœur Rosine et mère Berta... et ce sur la plus grande scène du nouveau continent. A l'âge de dix ans, elle va perdre son père, ne subissant pas la dictature qu'il a infligé à sa sœur. D'un caractère facile et gentil, elle est la petite dernière à qui l'on passe beaucoup de choses. Du coup, elle se souviendra de son père avec les mots suivants en 1859 : "C'est à présent seulement que je reconnais tout ce qu'il y a dû avoir d'élasticité et de charme et d'entrain dans mon père ! Je n'ai éprouvé que de la tendresse de sa part, il m'aimait passionnément et délicatement. Lui qui a été, dit-on, si sévère et si violent avec ma sœur, il a usé d'une douceur angélique avec moi". Car pour les deux ainés, l'apprentissage aura été réalisé à coup de bâtons plutôt qu'avec gentillesse.
 Pauline Viardot au piano, Alfred de Musset à la Harpe. Dessin de George Sand
Pauline Viardot au piano, Alfred de Musset à la Harpe. Dessin de George SandBien sûr, cette gentillesse n'empêche pas une solide formation musicale dès son plus jeune âge, et le piano la trouve fort bien disposée, à tel point qu'elle va rapidement pouvoir accompagner les jeunes élèves de son père, parmi lesquels on trouvera pas exemple un certain Adolphe Nourit (créateur entre autres de Guillaume Tell, Robert le Diable ou La Juive!). Une fois son père mort, elle se lance dans la piano avec entêtement, refusant de devenir cantatrice. Elle a pourtant assimilé tous les conseils de son père lors des cours qu'il donnait aux autres. Entre 12 et 14 ans, elle aura entre autres comme professeur un Franz Liszt de 25 ans, qui faisait alors tourner la tête de toutes les jeunes filles de Paris. Se voulant accompagnatrice, Pauline va réussir à accompagner sa soeur et son nouveau beau-frère Charles de Bériot (violoniste virtuose) à l'âge de 15 ans, le 14 Août 1836, avec dans le public, un certain Meyerbeer entre autres. Les comptes rendus seront unanimes pour noter la qualité des trois artistes sur scène. C'est malheureusement quelques jours après que Maria va annoncer à sa sœur le fait qu'elle est condamnée suite à sa chute de cheval.
Pauline et Joaquina se retrouvent alors seules... et alors que la jeune fille chante un air de Rossini en l'honneur de l'anniversaire de sa mère, cette dernière aurait dit : "Ferme ton piano, tu chanteras désormais !" Ainsi allait commencer la carrière de la sœur de la Malibran. Le défit était de taille. Reprendre le flambeau de la famille bien sûr, mais aussi de sa sœur, morte peu de temps auparavant au fait de sa gloire
II. Les débuts de la nouvelle GarciaAvec les conseils de son frère, sa mère et son beau frère qui vont parfaire une formation déjà assez complète, la jeune fille est prête pour faire ses débuts en tant que chanteuse en décembre 1837, au cours d'un gala de charité où seront présents rien moins que le Roi, la Reine et tout la bonne société de Bruxelles. Le triomphe est complet et la jeune femme va alors pouvoir partir en tournée, chantant le même répertoire que sa sœur morte il y a peut. Les voix sont très proches et on croit alors avoir la nouvelle Malibran. Peut de temps après, elle va rencontrer Clara Wieck (future Clara Schumann) ou encore George Sand qui deviendront de grandes amies.

Le 15 décembre 1838, elle fait ses débuts sur la scène du Théâtre de la Renaissance, face au public encore sous le charme de sa sœur. La curiosité est grande pour ces amateurs éclairés. Le succès est immédiat devant cet instrument si impressionnant. Saint-Saëns pensera alors "à la saveur de l'orange amère, faite pour la tragédie ou l'épopée, surhumaine plutôt qu'humaine". Elle va rapidement commencer à s'intéresser à un répertoire autre que celui de sa sœur, proposant en février 1839 un récital composé de Lieder de Schubert ainsi qu'un duo de l'Orphée et Eurydice de Glück. Elle réussit donc à s'imposer sur la scène française, et ses débuts à Londres dans l'Otello de Rossini le 9 mai 1840 sont là encore un triomphe, malgré les comparaisons obligatoires ! Alfred de Musset écrira : "La Malibran jouait Desdémone en Vénitienne et en héroïne ; l'amour , la colère, la terreur, tout en elle était expressif ; sa mélancolie même était énergique, et la romance du Saule éclatait sur ses lèvres comme un long sanglot... Pauline Garcia, qui, du reste, n'a pu voir jouer sa sœur qu'un petit nombre de fois, a imprimé au rôle entier un grand caractère de douceur et de résignation. Ses gestes craintifs, modérés, trahissent à peine le trouble qu'elle éprouve. Son inquiétude et le pressentiment secret de sa destinée, pressentiment qui ne la quitte pas, ne se révèlent que par des regards tristes et suppliants, par de tendres plaintes, par de doux efforts pour ressaisir la vie. Ce n'est plus la belle guerrière, c'est une jeune fille qui aime naïvement, qui voudrait qu'on lui pardonnât son amour, qui pleure dans les bras de son père au moment même où il va la maudire, et qui n'a de courage qu'à l'instant de la mort".
On trouve ici la grande force de Pauline : elle allait au fond des personnages, se documentant énormément avant de faire une prise de rôle, créant elle même ses costumes. Elle montre ici toute son intelligence.
III. Un mariage d'une grande stabilité Louis Viardot
Louis ViardotGeorge Sand est devenue rapidement une grande amie pour Pauline. Se sentant très attendrie par cette jeune fille, elle s'en sent très proche, comme une sorte de mère/amie. Et c'est elle qui va penser au mariage entre la jeun fille et Louis Viardot. Amis de la famille Garcia (il osait même faire des critiques à la Malibran sur sa façon de chanter!) et de George Sand, c'est un homme très cultivé, mais de 21 ans l'ainé de Pauline. Grand passionné de musique, il est aussi un fervent républicain et un agnostique convaincu. Le 18 avril 1840, elle va épouser cet homme qui la rassure. Alors directeur du Théâtre Italien, ce n'est pas un calcul pour les Garcia. Pauline cherche un soutien, un ami, quelqu'un qui la comprenne. Et ils vont former un couple soudé tout au long de leur vie. Elle soutenant son mari dans ses prises de position politique, allant par là mettre en danger sa carrière à Paris (ils quittent Paris en 1862 pour fuir Napoléon III et vont se réfugier à Baden-Baden), et lui lui prodiguant conseils et soutient. Leurs enfants auront une vie heureuse, mais loin de leur parents puisque ceux-ci devront continuellement parcourir l’Europe en laissant leurs enfants à la maison. Pauline n'a rien d'une mère ou presque, mais elle est attachée à ses enfants, source de calme et d'un sentiment de famille nécessaire à son équilibre.
 Ivan Tourgueniev
Ivan TourguenievLa rencontre d'Ivan Tourgueniev en 1843 ne mettra jamais en péril ce couple. Le poète russe ne cache en rien son amour profond pour la cantatrice. Cette dernière n'est pas insensible au triste regard du poète, mais aucune preuve ne montre qu'il y ait peu y avoir adultère. D'autant plus que rapidement, le poète russe va devenir un membre à part entière de la famille. Le malheur pour Pauline sera de voir ses deux hommes mourir à quelques temps d’intervalle en 1883 (le 5 mai pour Louis, le 3 septembre pour Ivan).
IV. Sa carrière de chanteuse Lithographie de Pauline Viardot en Valentine et Marietta Alboni en Urbain dans les Huguenots de Meyerbber (Acte I, Scène 9) au Royal Opera House de Londres
Lithographie de Pauline Viardot en Valentine et Marietta Alboni en Urbain dans les Huguenots de Meyerbber (Acte I, Scène 9) au Royal Opera House de Londres1839 : Débuts scéniques dans
Otello de Rossini à Londres. Débuts parisiens à l'Odéon dans
Otello,
la Cenerentola,
Il Barbiere et
Tancredi1840 : 15 décembre, chante le
Requiem de Mozart pour le retour des cendres de Napoléon
1841 : Débuts à Vienne en Rosina dans
Il Barbiere di Siviglia1842 : 11 octobre, débuts dans le rôle d'Arsace dans
Semiramide de Rossini
1843 : Débuts à Saint-Pétersbourg
1844 : Deuxième saison russe, début dans
Norma de Bellini
1848 : Concert avec Chopin où elle chante des Mazurkas du pianiste qu'elle a arrangé pour la voix.
1849 : 16 avril, création du rôle de Fidès dans
le Prophète de Meyerbeer (rôle composé pour elle)
 Pauline Viardot dans le rôle de Fidès
Pauline Viardot dans le rôle de Fidès1851 : 16 mars, création de
Sapho de Gounod. Elle a elle-même apporté son soutient pour la composition de cet opéra d'un jeune novice qui sera représenté sur la scène de l'Opéra de Paris.
1855 : Chante Azucena dans
Il Trovatore de Verdi à Londres
1859 : Chante
Lady Macbeth dans l'opéra de Verdi à Dublin et Manchester – 18 novembre, première de l'
Orphée de Glück révisé par Berlioz et elle-même
1860 : Mai,
Fidelio au Théâtre Lyrique - Juillet, incarne
Isolde dans une représentation privée de l'acte II, avec en Tristan Richard Wagner.
1861 : Chante
Alceste de Glück à l'Opéra de Paris
1870 : Crée la
Rhapsodie pour contralto de Brahms à Iéna
1873 : Chante
Marie-Magdeleine de Massenet à l'Odéon
1874 : Chante
Dalila (actes I et II) dans une représentation privée.
V. Une vie après le chantÉpuisée physiquement et vocalement par une carrière qui lui aura pris une grande partie de sa vie, Pauline Viardot fait ses adieux à la scène parisienne en 1863, soit au bout de 24 ans de bons et loyaux services. Elle ne s'est jamais économisée, sillonnant l’Europe, chantant sans se ménager pour toujours donner plus dans les rôles les plus divers. Aussi va-t-elle petit à petit se tourner vers les cours de chant, mais aussi vers la composition qui lui tient tant à cœur. Alors que jeune déjà, elle avait une grande affection pour les salons, elle va créer son propre salon pour y accueillir ses amis, sa famille. Déjà à Baden-Baden, elle aimait à proposer des moments de musique dans son grand salon. Mais une fois qu'elle a terminé de chanter, elle va encore plus profiter de son bonheur, composant des mélodies ou des opéras de salons pour ses élèves ou ses enfants. Bon nombre ne seront pas reprises hors du salon pour les opéras, mais les mélodies ont un certain succès et elle les chante régulièrement en récital. A noter que grâce à ses nombreux voyages dès sa jeunesse, elle parle espagnol, français, anglais, allemand, russe et italien. Elle composera d'ailleurs des mélodies dans ces différentes langues.
Toujours active dans la vie musicale malgré sa retraite, bon nombre de pièces seront créées chez Pauline Viardot parmi lesquelles le Concerto pour Piano de Grieg en 1877 ou encore le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns en 1886. Elle rencontrera aussi deux fois Tchaïkovsky dans cette période.

Toujours passionnée par Mozart, elle va faire dont à la bibliothèque du Conservatoire de Paris du manuscrit de Don Giovanni qu'elle avait acheté en 1855, sacrifiant alors une grande partie de sa fortune.
En 1901, elle reçoit la légion d'honneur.
Sa dernière création sera son opéra de salon Cendrillon le 23 avril 1904.
Elle meurt le 18 mai 1910 dans on appartement parisien à près de 89 ans. Le 20 mai 1910, la cérémonie funèbre rassemble quelques centaines de personnes, se souvenant de l'immense dame qui s'en va. Sa longue vie après ses triomphes scénique aura fait oublier le succès qu'elle rencontra, les génies qu'elle inspira et ceux qu'elle ensorcela par sa voix.
Chantant tout autant du Rossini, du Bellini, du Meyerbeer que du Haendel ou du Glück, cette femme allait quelque peut à l'encontre de l'époque par sa démarche intellectuelle des rôles, sa façon de vouloir montrer un autre répertoire au public. De par sa gentillesse et son amour des arts, elle aura parmi ses amis les plus grands noms de la culture de l'époque : Chopin, George Sand, Berlioz, Liszt, Tourgueniev, Flaubert, Zola, Gounod, Fauré, Tchaïkovsky, Wagner, Saint-Saëns.
VI. Une femme de caractèreSi La Malibran possédait une beauté romantique parfaite comme en témoignent un grand nombre de ses portraits, Pauline Viardot avait elle un physique qu'on pourrait dire ingrat au premier regard. Mais en approfondissant, ses contemporains y trouvaient au final une beauté étrange. Elle semblait provoquer une sorte de fascination de part sa personnalité. Ainsi, Ary Scheffer, grand ami de Louis Viardot, va la décrire ainsi : "Elle est terriblement laide, mais si je la revoyais à nouveau, je crois que je tomberait follement amoureux d'elle." De même, le poète Heine la trouvait "laide, mais d'une sorte de laideur qui est noble, je pourrais presque dire belle, et qui a parfois ravi en extase le grand peintre de liens, Delacroix. En effet, Mlle Garcia ne rappelle guère la beauté civilisée et la grâce apprivoisée de notre patrie européenne, mais bien plutôt la splendeur sinistre d'un exotique paysage dans le désert". Et pour terminer, Théophile Gautier écrira : "Nous avons entendu dire qu'elle n'est pas jolie ; mais ce n'est pas notre opinion : elle est bien faite, élancée, avec un cou souple, délié, une tête attachée élégamment, de beaux sourcils, des yeux onctueux et brillants dont la petite prunelle noire fait plus vivement encore ressortir la nacre limpide, un teint chaud et passionné, une bouche un peu trop épanouie peut-être, mais qui ne manque pas de charme, ce qui constitue une beauté théâtrale très satisfaisante."
 Pauline Viardot dans le rôle d'Orphée en 1860
Pauline Viardot dans le rôle d'Orphée en 1860Côté voix, on se réfèrera à la critique d'Hector Berlioz du 13 octobre 1839 dans le "Journal des Débats" :
"Jamais, en effet, à part Mme Malibran elle-même, ce mélancolique caractère de Desdemona ne fut plus admirablement compris. La voix de Mlle Garcia, d'une pureté virginale, égale dans tous les registres, justes, vibrante et agile, n'embrasse pas trois octaves et demie, comme une faute d'impression l'a fait dire à l'un de nos meilleurs critiques ; elle s'élève seulement du fa grave au contre ut (deux octaves et une quinte), et cette étendue est déjà immense, puisqu’elle réunit trois genres de voix qui ne se trouvent jamais réunis : le contralto, le mezzo-soprano et le soprano.
Sa méthode parfaite, elle est sobre d'ornements, elle termine les phrases énergiques avec aplomb et fermeté ; celle du dernier air [d'Ottelo de Rossini], Interpida morro, a fait éclater l'enthousiasme de l'auditoire. Quant aux mélodies lentes et tristes, il faut entendre la romance du Saule pour se faire une idée du charme attendrissant qu'elle sait leur prêter. Et le mérite de sa pantomime simple autant qu'expressive, la grâce de ses attitudes de colombe blessée, égalent presque dans cette scène le pathétique de son chant.
Cette voix, dans quelques années, acquerra de l'ampleur et de la force ; l'habitude du théâtre donnera à l'actrice des moyens qui lui manquent encore pour ne jamais laisser pendant qu'elle est en scène, l'action se refroidir ; mais on peut le dire dès aujourd'hui : pour le Théâtre-Italien au moins, Mlle Pauline Garcia est évidemment la cantatrice qui a le plus d'avenir, et sur laquelle reposent aujourd'hui les plus chères espérances des amis de l'art."
A noter d'ailleurs que selon d'autres observateurs, la voix couvrait trois octaves, du fa grave au contre fa.
Bien sûr, cette critique date de ses débuts. Et durant les ans, la voix va évoluer, perdre de cet angélisme pour gagner en drame. Et d'une soirée sur l'autre, l'instrument pourra se rebeller, comme en témoignent des critiques assez violentes de l'époque (l'aigu devenait strident, les trilles approximatives ou le grave sourd). Il faut dire que le rythme du chant et des voyages n'était pas fait pour soigner une voix !
VII. Les deux sœurs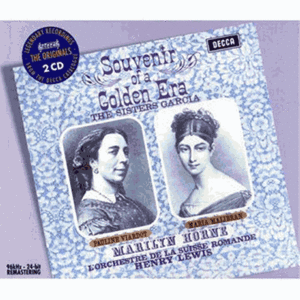
Elles n'auront jamais été rivales, ou du moins directement. Pauline ne commençant à chanter qu'après la mort de sa sœur, elle n'aura eu que le souvenir de sa sœur à combattre. Que... ce qui est déjà beaucoup . Car durant tout le début de sa carrière, restant sur le même répertoire, chacune de ses apparitions sera jugée, du moins pour les premiers instants, à l'aune des souvenirs idéalisés de sa sœur. Malgré tout, petit à petit, elle va se libérer du fantôme de sa sœur, mais aussi de son père.
Étant donné la grande différence d'âge, Pauline a été choyée par sa sœur quand elles étaient sous le même toit, mais cela ne dura au final pas si longtemps. Par la suite, une grande complicité les lira toujours, et ce malgré leur enfance si différente. Car si Pauline a eu une enfance heureuse, il ne faut pas oublier que Maria a supporté le caractère plus que difficile de son père.
Ce qui est étrange est la différence de l'emprunte des deux femmes dans l'histoire, ou du moins dans la mémoire collective. La Malibran reste une chanteuse mythique, nimbée de sa beauté et de son talent, mais aussi de sa mort au sommet... Pauline Viardot reste de nos jours la sœur de Maria, ou l'amante de Tourgueniev. Et pourtant... Les deux femmes auraient eu au final sûrement une carrière similaire sans l'accident de Maria. En effet, durant les derniers mois de sa vie, avant son accident, les critiques commençaient à noter une certaine usure de l'instrument, usure qu'on reprochera quelque peu à Pauline par la suite. Toutes deux étaient compositrices, mais là où la Malibran n'a laissé que quelques rares mélodies, Pauline Viardot nous laisse une beau corpus de mélodies, mais aussi ces quelques opéras de salon ou encore des adaptations pour piano. D'une formation musicale plus poussée que sa grande sœur, Pauline a intégré tous les courants de composition de l'époque. Moins médiatique et romantique, elle reste de nos jours dans l'ombre alors que les deux soeurs devraient se tenir à égalité !
VIII. Les compositions :Opéras :1867 : Trop de femmes (Ivan Tourgueniev)
1868 : L'ogre (Ivan Tourgueniev)
1869 : Le dernier sorcier (Tourgueniev)
1879 : Le conte de fées
1904 : Cendrillon
Chœurs :Chœur bohémien
Chœur des elfes
Chœur de fileuses
La jeune République
Mélodies :1843 : Album de Mme Viardot Garcia
1843 : L’Oiseau d'ornements
1848 : 12 Mazurkas pour piano et voix sur des oeuvres de Frédéric Chopin
1874 : Duo, 2 solo pour voix et piano
1874 : 100 mélodies, incluant 5 Gedichte
1880 : 4 Lieder
1881 : 5 Poésies toscanes sur des textes de Louis Pomey
1884 : 6 Mélodies
1886 : Airs italiens du XVIII
6 chansons du XVème siècle
Album russe
Canti popolari toscani
Arrangements sur des pièces de Johannes Brahms, Joseph Haydn et Franz Schubert
Instrumental :1885 : 2 airs de ballet pour piano
1885 : Défilé bohémien pour piano à 4 mains
1874 : Introduction et polonaise pour piano à 4 mains
1868 : Marche militaire pour 2 flûtes et piccolo, 2 Hautbois et 2 cors
1868 : Marzurka pour piano
1868 : 6 morceaux pour violon et piano
1874 : Second album russe pour piano
1874 : Sonatine pour violon et piano
Suite arménienne pour piano à 4 mains
Source : Source: Rachel M. Harris,
The Music Salon of Pauline Viardot IX. Pour continuerA lire :Pauline Viardot, par Patrick Barbier, chez Grasset.
Livre passionnant, très détaillé mais très bien écrit aussi !
A écouter :Pauline Viardot :
Cendrillon (Chez Opera Rara, dirigé par Nicolas Kok, avec Sandrine Piau, Elisabeth Vidal, Jean-Luc Viala...)
Pauline Viardot :
Mélodies (Chez Ars Musi Ci, avec Lambert Bumiller au piano, chanté par Györgyi Dombradi)
Pauline Viardot and Friends (Chez Opera Rara, Divers mélodies de Pauline Viardot ou composées par ses amis. David Harper au piano, Frederica von Stade, Vladimir Chernov et Anna Caterina Antonacci au chant et Fanny Ardant en récitante)
Marylin Horne : Souvenir of a Golden Area (dirigé par Henry Lewis : Il Barbiere di Siviglia, I Capuleti e I Montecchi, Fidelio, Otello, Tancredi, Semiramide, l'Italiana in Algeria, Orphée et Euridyce, Sapho, le Prophête, Alceste, Il Trovatore)
Johannes Brahms :
Rapsodie pour AltoChristoph Willibald Glück/Hector Berlioz :
Orphée et Eurydice (Chez EMI, dirigé par John Eliot Gardiner, avec Anne-Sophie von Otter, Barbara Hendricks, Brigitte Fournier)
Charles Gounod :
Sapho (Chez Gala, dirigé par Sylvain Cambreling, avec Catherine Ciesinsky, Alain Vanzo, Eliane Lublin, Frédéric Vassar)
Charles Gounod :
Sapho (Chez Koch Schwan, dirigé par Patrick Fournilier, avec Michèle Command, Christian Papis, Sharon Coste)
Giacomo Meyerbeer :
Le Prophète (Chez Sony, dirigé par Henry Lewis, avec Renata Scotto, Marylin Horne, James McCracken, Jerôme Hines)
Les premiers pour voir un peu à quoi correspond ses talents de compositrices, alors que les derniers peuvent nous donner une idée de la voix qu'elle possédait.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voilà... je dois dire que la vie de cette femme est passionnante, et en lisant la biographie de Patrick Barbier, j'ai encore plus été convaincu de la place importante qu'elle a eu dans le XIXème siècle artistique. Donc cet dossier pour lui rendre hommage et essayer de la faire découvrir à ceux qui ne connaissent d'elle que le nom ou presque.
Une bonne partie des informations a été trouvée dans la superbe biographie de Patrick Barbier, mais aussi dans divers autres sources. En complément de cette biographie, par le même auteur on peut trouver la biographie de La Mallibran, toute aussi passionnante !
En espérant avoir été clair et intéressant !
